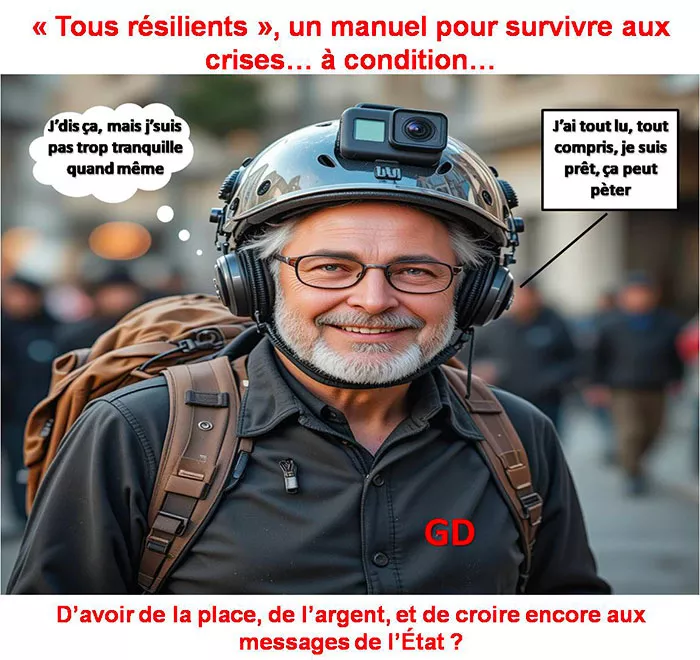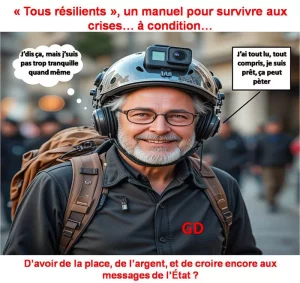« Tous résilients », un manuel pour survivre aux crises… à condition…
C’est l’antienne du jour, de chaque heure, les présentateurs, journalistes, experts reviennent en boucle autour du fameux manuel, « Tous résilients », qui attend la validation du 1ᵉʳ ministre.
Validé par le gouvernement, le guide promet de préparer chaque Français à l’urgence. Mais derrière le discours carré, le coût, l’accessibilité et la défiance héritée du covid pourraient transformer l’outil en belle illusion.
Manuel national « Tous résilients » : entre promesse et réalité
Élaboré depuis mars 2025 par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN), le Manuel national de survie – Tous résilients – attend d’être validé par le Premier ministre. Objectif affiché : préparer chaque citoyen français aux crises majeures – catastrophes climatiques, accidents industriels, pandémies, menaces sécuritaires – avec un plan clair pour se protéger, réagir vite et s’engager dans la solidarité collective.
Sur une trentaine de pages, le manuel détaille trois axes :
- Se protéger – constituer un kit de survie comprenant eau potable, nourriture non périssable, lampe de poche, radio à dynamo, trousse médicale, documents essentiels, chargeurs et batteries portables.
- Que faire en cas d’alerte – repérer et réagir aux signaux officiels (FR-Alert, sirènes, messages radio/télé), se calfeutrer, évacuer, couper gaz et électricité, se tenir informé toutes les 15 minutes.
- S’engager – rejoindre les réserves opérationnelles, aider ses voisins vulnérables, participer aux réseaux locaux d’entraide.
Pour les lecteurs de Montceau News, nous avons ponctué chaque volet d’un rappel des “leçons du Covid” : en 2020-2021, pénurie de masques, improvisation dans les confinements, communication parfois tardive ou contradictoire, solidarité spontanée mais non coordonnée, etc. Nous avons essayé d’analyser le dit et le non-dit de cette démarche affichée comme partie d’une volonté de protéger les Français, leur état et leur pays.
« Tous résilients » : un titre qui en dit long sur la vision technocratique.
Le choix du titre « Tous résilients » n’est pas neutre. Il véhicule l’idée que l’ensemble des Français, quels que soient leurs moyens, leur situation géographique ou leur fragilité, peuvent et doivent être prêts à affronter n’importe quelle crise. Il y a de quoi traumatiser certains publics, augmenter le niveau de stress des Français et amolir leur réactivité face à une analyse critique de la situation.
Cette vision est typiquement technocratique : un objectif idéal posé en haut, censé s’appliquer à tous… mais pensé depuis des bureaux parisiens, loin des réalités disparates du terrain. En zones urbaines densément peuplées, dans les campagnes isolées ou les DOM-TOM, les contraintes matérielles et logistiques sont très différentes. Pourtant, le manuel ne module pas ses recommandations selon ces contextes, comme si la France était un bloc homogène.
Et puis il y a toujours dans les discours politiques un glissement sémantique qu’il convient d’analyser avec précision : de la responsabilisation… à la culpabilisation.
Sur le papier, le manuel veut responsabiliser : donner les clés pour se préparer, réagir, s’entraider. Mais l’absence de mesures concrètes d’accompagnement laisse planer un risque :
Si demain, malgré ce manuel, une crise tourne mal, la faute pourrait être renvoyée aux citoyens qui seront accusés de ne pas avoir suivi les consignes ou de ne pas s’être équipés.
On passerait ainsi d’une responsabilisation (je t’aide à devenir autonome) à une responsabilité pleine (si tu échoues, c’est à cause de toi), sous-entendu l’échec devient collectif de la faute de l’ensemble des comportements individuels inadéquats. Ce changement de posture, déjà perceptible dans certaines déclarations officielles pendant la crise de la covid, transforme un devoir collectif en charge individuelle.
Il convient de préciser qu’il s’agit là d’un plan carré, élaboré comme au cordeau… mais qui se heurte à la réalité du terrain
Derrière la clarté des recommandations, plusieurs questions se posent :
- Qui pourra réellement appliquer ces consignes ?
- Comment éviter que ce manuel ne reste un document théorique ?
- Quelles réponses face aux contestations ou à la défiance ?
Et comme à l’accoutumée, il y a ce que dit le manuel et ce qu’il tait : le coût et la logistique.
Sur le papier, se constituer un kit de survie paraît simple. Dans la réalité :
- Pour un foyer modeste, les achats de base (eau, conserves, lampes, piles, radio, trousse médicale, batteries) représentent 50 à 80 euros, plus pour tenir plusieurs semaines.
- Les logements exigus ou insalubres compliquent le stockage.
- Les personnes âgées isolées ou à mobilité réduite peinent à gérer ces réserves.
Lors du premier confinement, beaucoup ont dû se contenter d’achats quotidiens faute de moyens ou d’espace. Le manuel ne prévoit aucun dispositif de soutien, laissant craindre une préparation à deux vitesses : ceux qui peuvent s’équiper et ceux qui resteront au stade de l’intention. Ou encore ceux qui spolieront les autres en stockant à outrance. Rappelons-nous l’épisode du contrôle des caddies.
De Paris, l’on ne considère pas la réalité des zones blanches, du parc téléphonique extrêmement hétérogène, de l’absence dans certaines familles, chez certaines personnes de l’Internet, du smartphone. L’accessibilité et la communication : un angle mort
Le manuel s’appuie sur FR-Alert, les sirènes et les médias traditionnels. Or, l’expérience de la covid a montré :
- que tous ne disposent pas d’un smartphone ou d’un réseau fiable,
- que les messages officiels peuvent arriver trop tard ou être mal compris,
- que des publics entiers — sans-abri, migrants, personnes peu francophones — restent hors des radars.
Sans traduction systématique ni relais locaux (associations, communes, réseaux de quartier), ces recommandations risquent de ne jamais atteindre ceux qui en ont le plus besoin.
A-t-on retenu les leçons de la période covid : réactivité… et défiance ?
Et les a-t-on retenues de la même manière de la part de ceux qui imposaient et de la part de ceux à qui les règles étaient imposées ?
En 2020, la rapidité d’exécution était cruciale : annonces de couvre-feu, attestations, fermetures administratives. Mais la pandémie a aussi révélé :
- une fatigue sociale face aux changements incessants,
- une méfiance accrue envers la parole publique,
- le rôle ambivalent des réseaux sociaux : entraide et mobilisation, mais aussi désinformation fulgurante.
Le manuel 2025 ne traite ni de la lutte contre les rumeurs ni de la façon de maintenir la crédibilité de l’État — pourtant essentielles pour que les consignes soient suivies.
On sait que des oppositions et des contre-pouvoirs sont nés à cette époque et se sont développés, enkystés depuis. Il convient de rappeler que Montceau-les-Mines fut un des foyers majeurs des gilets jaunes.
Toute directive nationale se heurte à des résistances :
- Idéologiques : refus de l’ingérence étatique, crainte d’un contrôle accru.
- Économiques : inquiétudes des commerçants et entreprises face aux fermetures ou évacuations.
- Politiques : élus locaux ou mouvements contestant la pertinence des mesures.
Pendant le covid, ces tensions se sont traduites par des manifestations, des refus du port du masque, des appels à la désobéissance civile. Le manuel reste muet sur leur gestion.
Si nous étions complotistes, nous pourrions dire que le Manuel national « Tous résilients », à valider en 2025, affiche l’objectif de préparer chaque citoyen aux crises, mais son contenu dépasse la simple prévention. Officiellement centré sur la sécurité civile, il fixe un cadre de comportements attendus en cas d’alerte, renforçant la légitimité de l’État à imposer des mesures coercitives. Inspiré des leçons du covid, il peut aussi servir à normaliser l’obéissance et limiter les contestations. Le précédent des Gilets jaunes et de la pandémie montre comment des dispositifs de sécurité peuvent aussi contenir les mouvements sociaux. Dans un contexte de rentrée 2025 potentiellement agitée, ce manuel prépare psychologiquement la population à accepter restrictions et contrôles. Sous couvert de résilience collective, il existe un glissement entre responsabiliser et rendre responsables les citoyens si tout va mal. Cette ambiguïté alimente la méfiance envers un État perçu comme technocratique et déconnecté du terrain. La résilience risque alors de devenir synonyme de discipline imposée.
Mais à Montceau News nous ne sommes pas complotistes.
Alors en conclusion on peut dire que la résilience ne se décrète pas par PDF. Sans soutien concret, communication adaptée et confiance mutuelle, ce manuel restera ce qu’il est aujourd’hui : un beau fichier à télécharger… et à oublier au premier coup de sirène.
Gilles Desnoix